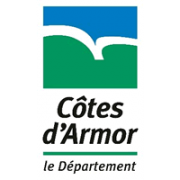Dans notre société contemporaine la où les questions relatives au groupe n’en finissent pas de s’élaborer que se passe t’il lorsque ces questions s’éprouvent ?
C’est un peu avec ce questionnement, cette forme de curiosité, que l’équipe du PAEJ CapJeunes et le service jeunesse et prévention de Belle Isle en Terre se sont « invités » auprès des élèves du niveau 4ème du collège du Prat Eles entre avril et juin 2025 afin de convier ses élèves à participer à une action collective.
Avec la proposition de collaboration autour du programme « En visage », une tentative d’un changement de point de vue s’est opérée.
Dans l’imaginaire commun « collectif » renvoie à « ensemble ».
Si l’on s’arrête sur l’étymologie du mot « ensemble » en latin « insimul », « en même temps », mais alors s’agit-il de faire « en même temps » lors d’une action collective ? L’enjeu est-il d’être là ? de contribuer par sa présence ? de faire une offre de parole qui se veut différente du cadre scolaire tout en y étant ou encore d’expérimenter ?
Cette proposition de partage peut ainsi être entrevue comme un pari sur la portée de dire, de nommer, d’éprouver…
Ainsi pendant quelques heures, et avec pour support des vidéos qui traitent du quotidien de différents collégiens, nous avons renouvelé l’expérience de vivre, faire, parler « ensemble ». La proposition de l’éprouvé, du vécu a ici trouvé un sens avec le partage, avec cette idée d’y être « en même temps ».
A l’heure où les compétences « psycho sociales » sont désignées comme un des enjeux de la sphère scolaire, comment les PAEJ peuvent contribuer à prendre le temps, à dire, à nommer ce qui se vit, ce qui s’éprouve du côté de la jeunesse ?
C’est un peu de chacun et de tous à la fois qui se joue lorsque l’équipe du PAEJ s’emploie à faire vivre en collectif ce programme et fait le pari que la parole se déplie.
Tout d’abord timidement, puis de manière plus bruyante, pour enfin ne pas, ne plus se taire pour certain(e)s, chacun y a trouvé une manière, à lui, d’y être et d’y participer. C’est d’ailleurs, a posteriori ce qui s’impose comme une évidence : cette offre dont ils se sont saisis et qui a permis, parfois, l’émergence d’une forme d’individualisation.
Penser par soi-même, grâce aux autres. Est-ce un paradoxe ?
Là où on peut reprocher aux jeunes générations de ne pas se parler, de ne pas ou mal faire usage du langage oral, les rencontres avec ces collégiens sont venues réaffirmer la nécessité d’une offre de parole accessible, adaptée et qui, avant tout autre chose, permet l’écoute avant que puisse s’énoncer la pensée comme s’exprimer les ressentis émotionnels.
A posteriori nous mesurons combien il est finalement difficile de nommer cette « expérience », ce « Programme », cette « proposition » … et cette réalité n’est que le reflet de la complexité de ce qui se joue dans le groupe.
S’il y a des individualités qui peuvent « jongler » aisément entre le collectif et l’individuel ce n’est pas le cas de tous mais pour autant, chacun à leur façon, ces jeunes ont pu prendre une place, prendre la parole pour certains et s’exprimer en leur nom propre et ainsi se différencier, s’individuer.
Pour exemple évoquons cette jeune fille qui lors de la première séance restera silencieuse, observatrice avec même une certaine forme de détachement. Lors de la seconde rencontre elle s’autorisera à prendre timidement la parole et à dire ce qui la fait réagir. Enfin la troisième séquence la verra se positionner, argumenter, contre argumenter, dire, réagir…comme si la confiance acquise dans ce collectif lui avait permis de s’autoriser à se positionner, à affirmer, à porter la responsabilité de ce qu’elle énonce, qui elle est et ce qu’elle pense.
Tout se passe ici comme si la notion, « d’en même temps » venait rendre possible le « dire ».
Le collectif permet de dépasser les limites d’une réflexion uniquement personnelle. En partageant ses idées, en écoutant celles des autres, chacun peut mettre en mouvement sa propre pensée, la confronter, la préciser. Cette interaction devient un levier : elle ouvre un espace où l’on apprend à formuler ce que l’on pense vraiment, à affirmer un point de vue sans se couper du regard des autres. C’est dans cette dynamique que peut émerger la singularité de chacun — portée, nourrie et renforcée par la présence du groupe.