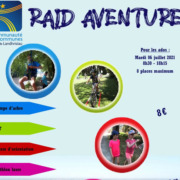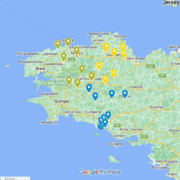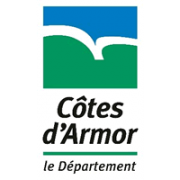Permettre un espace pour réfléchir, élaborer, s’émanciper
L’adolescence inscrit le.la jeune dans le processus de « devenir adulte ». Mais quel adulte être ? Vers où aller ? Quel choix faire ? Vers qui aller ? Comment s’orienter soi-même ? Des questions, parfois vertigineuses auxquelles la personne la plus apte à y répondre est bien le.la jeune lui.elle-même ! Et ce n’est pas toujours simple, le.la jeune se retrouve face aux attentes que son environnement a pour lui.elle, celles de sa famille, de ses proches, de ses ami.e.s, de son école, et plus largement de la société. « Tu feras comme ton père », « Il faut que tu passes ce bac professionnel », « Tu devrais être plus calme », « Je veux que tu restes à la maison », « Tu n’aimes pas l’école », « Il faut travailler », etc. L’enjeu n’est pas de nier les attentes ou les projections des autres, mais d’avoir l’espace de choisir pour soi-même, petit à petit, au fil de l’âge. C’est un réel défi, qui ne s’arrête d’ailleurs pas à l’adolescence.
Un espace pour soi
Lorsqu’un.e jeune arrive au PAEJ dans le cadre d’un entretien, l’enjeu est de pouvoir accueillir sa parole, que souhaite-t-il.elle dire ? Cela lui appartient. Nous écoutons et essayons de comprendre sa demande. Parfois, il.elle ne reviendra pas, et il.elle a le droit. D’autres fois, il.elle revient, parle, évoque petit à petit ce qu’il.elle souhaite. Le.la jeune reste toujours libre de venir, c’est lui.elle qui décide. Le lieu se veut à l’écoute de ses mots sans lui faire porter des attentes. Ce contexte note la notion de « permettre » à la personne de dire et de ne pas dire, de revenir ou non, c’est un espace qui tend à donner au jeune le pouvoir de ce qui se passe et de ce qui se dit. L’anonymat et la confidentialité qui sécurisent les rencontres individuelles soutiennent la possibilité de dire permettant à la personne, si elle le souhaite, de réfléchir et d’élaborer sur elle, sur ce qui la tracasse, l’angoisse ou l’interroge.
Aussi, cet accueil tend à soutenir et à considérer le.la jeune dans sa pensée, dans ses mots, sans jugement ni attente. Préserver de cela, c’est un espace de liberté dont la personne peut se saisir.
« Permettre » un espace pour dire, pour s’exprimer, pour réfléchir, se fait également dans le cadre d’actions collectives.
La force de l’échange collectif
L’objectif de nos interventions auprès de groupes est d’ouvrir un espace d’échange pour que les jeunes s’interrogent, pour qu’ils.elles puissent être acteurs.ices de leurs savoirs, de leurs apprentissages, de leurs réflexions. A partir d’une thématique de départ, notre enjeu est de permettre aux jeunes d’en dire quelque chose.
Au sujet du consentement, la majorité tend à approuver que « Quand c’est non, c’est non ! ». Mais pourquoi est-ce qu’on en parle ? Pourquoi est-ce si présent dans les médias ? Pourquoi le consentement donne lui à tant de débat ? Lors d’une de nos interventions auprès de groupes de jeunes, sous forme de débat mouvant, les jeunes se déplacent donnant corps à l’échange. Face à plusieurs affirmations ils.elles se positionnent : « Je suis d’accord », « Je suis ni d’accord, ni pas d’accord », « Je ne suis pas d’accord ». Ils.elles apportent des réponses sur ce qui les ont fait se positionner là où ils ont choisi d’aller. Les jeunes expliquent, se questionnent et se laissent questionner. Leurs expériences de vie leur en ont donné pleins d’arguments, qu’ils.elles ne voyaient pas forcément. Avec des outils d’éducation populaire, les jeunes deviennent acteurs.ices de leur savoir. Pourquoi dit-on oui sans en avoir envie ? A cela ils.elles répondent : « Quand on est menacé », « quand on veut être tranquille », « quand on a peur que l’autre parte, qu’il.elle nous quitte », etc. Et l’autre pourquoi insiste-t-il ? Pourquoi se fâche-t-il ? Là aussi ils.elles savent, ils.elles imaginent. La question du consentement n’est pas l’affaire d’une poignée de « dégénéré.e.s ». Non, c’est l’affaire de tous.tes. Chaque humain.e peut se trouver victimes ou auteurs.ices. L’intention n’est pas de culpabiliser les personnes mais de comprendre le fonctionnement ensemble, « C’est quoi le consentement exactement ? ». Les jeunes s’écoutent, argumentent, discutent, alimentent leur réflexion par l’échange collectif, leurs positionnements peuvent parfois bouger. Prendre conscience en ouvrant la réflexion collective peut prévenir certaines situations. Essayer de se comprendre et de comprendre l’autre. Sortir de l’ignorance par l’élaboration, en mettant en valeur les jeunes et leurs expériences.
Valoriser la pensée et la réflexion des personnes, venir les questionner et accompagner l’élaboration, c’est ainsi que nous tendons à inscrire nos missions, pour que les premiers.ères acteurs.ices soient les personnes elles-mêmes.