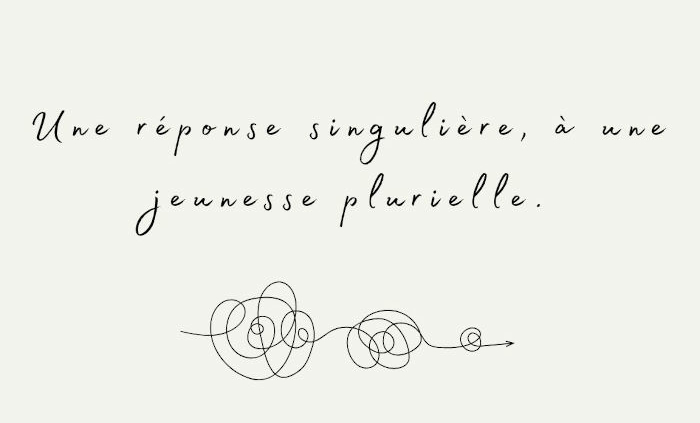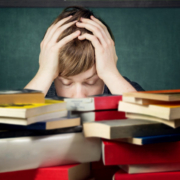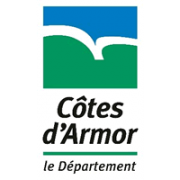Santé mentale des jeunes : que disent les pratiques en PAEJ ?
Depuis quelques années, la santé mentale s’impose comme une préoccupation majeure. Déclarée grande cause nationale cette année, elle occupe désormais une place centrale dans l’espace public : à la une des journaux, sur les réseaux sociaux, dans les conversations du quotidien. Chacun est invité à s’interroger : « Et moi, comment va ma santé mentale ? ». Cette nouvelle attention portée au bien-être psychique contribue à lever les tabous, à démocratiser la demande d’aide et à favoriser la venue des publics sur les dispositifs d’écoute, en particulier pour les jeunes.
Mais elle soulève aussi de nouvelles questions : si la santé mentale est « l’affaire de tous », alors qui en est garant ? Et comment agir de manière juste, cohérente, sans tomber dans des réponses normatives ? C’est dans ce contexte que j’ai mené, en 2024-2025, une recherche-action au sein du réseau breton des Points Accueil Écoute Jeunes (PAEJ), dans le cadre de mon Master 2 et de ma mission de coordinatrice régionale. Cette enquête visait à mieux comprendre comment s’organise, sur le terrain, l’accueil de la souffrance des jeunes, et à mettre en lumière les pratiques des professionnels de première ligne.
Un dispositif riche, mais encore flou pour beaucoup
Les PAEJ sont des lieux d’écoute anonymes, gratuits, accessibles sans condition. Leur objectif : accueillir les jeunes en situation de vulnérabilité, quel que soit leur demande. Pour comprendre leur spécificité, il faut revenir à leur histoire. Avant la création des PAEJ tels que nous les connaissons, deux types de structures coexistaient : les Points Accueil Jeunes (PAJ), et les Points Écoute Jeunes (PEJ). Ces deux dispositifs ont été créés pour apporter une réponse à la souffrance des jeunes mais sur la base également de constats de déviance qu’ils convenaient d’enrayer. L’idée alors est de créer des lieux pouvant se positionner dans un espace intermédiaire où la souffrance des jeunes serait prise en compte sans pour autant être médicalisée ni stigmatisée en intégrant les dimensions sociale, relationnelle et existentielle du mal-être basé de fait sur une approche pluridisciplinaire. Plus tard, c’est la circulaire du 20 mars 2002 qui marque une étape décisive en fusionnant les PAJ et PEJ dans une structure unifiée : les Points d’Accueil et d’Écoute Jeunes. Cette origine explique la richesse et la pluralité des PAEJ d’aujourd’hui : chaque structure est singulière et inscrite au sein d’un territoire donné qui en définit pour parti les axes d’orientation du service. Les actions menées, tout comme les profils professionnels mobilisés, varient. Cela rend le dispositif précieux mais parfois difficile à lire, tant pour les partenaires de terrain que pour les institutions, élus ou financeurs.
Une recherche au service d’une meilleure lisibilité
L’un des enjeux centraux de ma feuille de route en tant que coordinatrice du réseau est justement de rendre les PAEJ visibles et lisibles. Pas uniquement pour promouvoir le dispositif, mais pour en clarifier les missions, les modalités d’action, les fondements éthiques, afin de renforcer son efficacité au service des jeunes.
La recherche que j’ai mené cette année en Bretagne visait un objectif : mieux comprendre comment les professionnels des PAEJ travaillent, autrement dit, sur quoi repose leur pratique, afin de rendre davantage lisible leur action. Ce que je n’avais pas anticipé c’est que cette recherche me permettrait également de comprendre ce que leurs pratiques nous disent de notre conception de la santé mentale.
Santé mentale : de quoi parle-t-on vraiment ?
En 2025, la santé mentale devient grande cause nationale. Une reconnaissance bienvenue, mais qui appelle à la nuance. Que recouvre cette notion, aujourd’hui ? La réalité rencontrée par les équipes des PAEJ est complexe. Elle révèle une conception située et plurielle de la souffrance psychique. Dans les entretiens réalisés, les professionnels, psychologues cliniciens, éducateurs spécialisés, assistants du service social, etc ; décrivent des situations où la souffrance du jeune ne relève pas uniquement d’une souffrance psychique individuelle, mais aussi du social, du relationnel : ruptures familiales, isolement, précarité, violences, injonctions sociales…sont autant de facteurs qui peuvent altérer l’équilibre psychique.
Une posture partagée, une éthique commune
Ce qui m’a marquée au fil de cette recherche, c’est qu’au-delà des différences de perception liées à la diversité des formations initiales, une posture commune semble traverser les pratiques professionnelles en PAEJ. Une posture d’écoute, de présence, et de responsabilité vis-à-vis de la parole du jeune. Certains évoquent une dynamique de transfert, d’autres parlent de relation éducative, mais tous décrivent une manière d’être là, sans présupposer ce que traverse le jeune. Un lien se tisse, qui permet à chacun de poser ses mots, de construire du sens, et d’envisager un équilibre au regard duquel il puisse se situer. Cette posture, profondément éthique, engage la responsabilité du professionnel face à ce qui lui est confié. Elle constitue, à mes yeux, le cœur de l’intervention en PAEJ. Refuser de réduire la souffrance à une seule cause de nature individuelle, c’est aussi admettre que les réponses ne relèvent pas d’un seul champ, d’un seul métier, ni d’un seul type d’intervention. C’est reconnaître que les responsabilités sont partagées, et que les moyens à mobiliser doivent être multiples et adaptés.
Soutenir l’organisation singulière des PAEJ, c’est affirmer que la souffrance psychique ne prend pas toujours racine dans une cause personnelle et individuelle. Elle peut aussi être la manifestation d’une souffrance sociale, d’un désajustement entre un jeune et le monde dans lequel il évolue. Soutenir le dispositif PAEJ, c’est ainsi soutenir une conception située de la santé mentale et des difficultés rencontrées par les jeunes. C’est reconnaître qu’il existe une autre manière d’envisager les responsabilités collectives, et de faire société.
Au sein des PAEJ, les équipes considèrent que la jeunesse est plurielle, et que de ce fait notre réponse ne peut être que singulière.