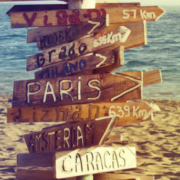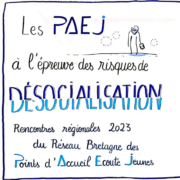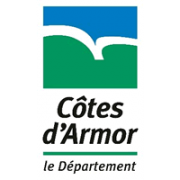Ciné-rencontres « Faire famille à l’adolescence »
Le PAEJ du Pays de Pontivy a souhaité proposer une modalité d’échange inédite à destination des parents du territoire en ouvrant une porte vers le champ culturel à travers des temps de discussion autour de films abordant les transformations du lien parent-enfant à l’adolescence. Aussi, le projet de ciné-rencontres en partenariat avec le cinéma Rex de Pontivy s’est lancé.
Des ciné-rencontres pour parler du lien parent-adolescent autrement
Un ciné-rencontre est un temps ouvert au public qui associe la projection d’un film et un échange collectif, animé par un ou plusieurs intervenants qui accompagnent la discussion et favorisent la prise de parole. Le film se fait support à la discussion. Bien qu’il s’agisse d’une fiction, d’une construction, il apporte une autre fenêtre sur le monde, une manière nouvelle de voir les choses par le regard d’un réalisateur.
La discussion en présence de professionnels permet d’amener différentes lectures de la parentalité et de l’adolescence. Ces regards croisés visent à ce que chaque parent présent puisse attraper dans la conversation un point qui lui fait écho, qu’il pourrait venir partager s’il le souhaite ou repartir avec un autre point de vue.
Mikado de Baya Kasmi
 Le PAEJ du Pays de Pontivy a proposé son premier ciné-rencontre le mardi 22 avril 2025 au CinéRex de Pontivy autour du film de Baya Kasmi Mikado. La discussion, animée par Delphine Gicquel, psychologue au PAEJ du Pays de Pontivy, a réuni Chloé Le Faucheur (psychologue, PAEJ de Guingamp), Perrine Petit (responsable pôle enfance, L’Envol, Saint-Brieuc) et Rachel Tisserand (éducatrice spécialisée, service de placement à domicile, L’Envol).
Le PAEJ du Pays de Pontivy a proposé son premier ciné-rencontre le mardi 22 avril 2025 au CinéRex de Pontivy autour du film de Baya Kasmi Mikado. La discussion, animée par Delphine Gicquel, psychologue au PAEJ du Pays de Pontivy, a réuni Chloé Le Faucheur (psychologue, PAEJ de Guingamp), Perrine Petit (responsable pôle enfance, L’Envol, Saint-Brieuc) et Rachel Tisserand (éducatrice spécialisée, service de placement à domicile, L’Envol).
Le film Mikado a ouvert la réflexion sur la manière dont une famille peut se séparer sans que tout ne soit déstabiliser et sur la place que chacun peut y trouver dans sa singularité.
Le personnage de Nuage, jeune adolescente, nous a enseigné sur ce temps de « délicate transition [1] » : elle se soustrait au regard des autres, à celui de ses parents notamment. Le film montre comment Nuage, sa curiosité pour ce qu’elle ne connait pas et son envie d’ailleurs, va se débrouiller peu à peu pour prendre son envol et aller là où elle veut sans disparaître. Voilà un enjeu majeur de l’adolescence que nous avons pu transmettre. En effet, cette période nécessite de se distinguer des positions parentales tout en y étant encore accroché. Celui qui ne la perd pas de vue c’est Mikado, son père, qui craint de la perdre. Et à vouloir la protéger du monde extérieur dont il a peur, il ne la laisse pas respirer. Sa propre enfance, marquée par une mère en souffrance, une vie en famille d’accueil, lui fait penser « qu’on va prendre mes enfants ». Baya Kasmi explore ici ce point fondamental : l’enfant que chaque parent a été, ce sur quoi le parent se construit, a un impact dans la manière d’éduquer un enfant. « En tant que parent on essaye de rattraper ses propres ratés » écrit-elle dans le dossier de presse. Les élever hors de la société (les enfants ne sont pas déclarés, ni scolarisés…), les rendre en réalité naïfs, incapables de se faire une place dans le monde, voilà une précaution inutile, qui déclenche même de l’agressivité : « laissez-moi ! », « c’est dégueulasse !» s’exclame Nuage qui tente de s’extraire des enjeux parentaux.
La conversation s’est poursuivie autour du thème de la rencontre, de ce qui se passe de manière contingente, qui peut produire un effet de surprise et permettre à l’adolescent de s’autoriser à être autrement que ce qu’il pense que ses parents attendent de lui.
Le film a démontré qu’il n’y a pas de solutions prêt-à-porter, qu’être parent d’adolescent se situe entre incertitudes et responsabilités et que chaque parent, différemment, a à inventer sa façon d’y faire pour soutenir un adolescent à devenir un adulte, à partir de sa propre expérience avec laquelle il se doit de prendre du recul.
Enfin, le film met en lumière la valeur de la parole, les efforts qu’elle suppose lorsqu’elle tente de dire la souffrance rencontrée. Il rappelle combien parler c’est déjà se séparer. Les PAEJ s’inscrivent précisément dans ce mouvement psychique en offrant à chacun – adolescent, parent ou professionnel – un espace où cette parole peut se déposer et se transformer.
TKT, t’inquiète de Solange Cicurel
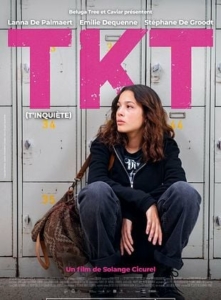 Le PAEJ du Pays de Pontivy a proposé son deuxième ciné-rencontre le lundi 14 octobre 2025, dans le cadre du Festival des Familles, au Cinérex de Pontivy. La discussion, animée une nouvelle fois par Delphine Gicquel, s’est appuyée sur la présence de deux autres intervenantes, permettant de croiser les regards autour des thématiques abordées. Sandrine Henry, psychologue clinicienne ayant travaillé dans un Centre d’Accueil à la Parentalité, lieu de prévention pendant de nombreuses années et actuellement dans le champ de la protection de l’enfance (Beauvallon, Saint-Brieuc) et Fabienne Gomez, éducatrice spécialisée au PAEJ de Saint-Brieuc (Beauvallon) ont contribué à enrichir les échanges avec la salle, en apportant leurs perspectives issues de contextes professionnels différents.
Le PAEJ du Pays de Pontivy a proposé son deuxième ciné-rencontre le lundi 14 octobre 2025, dans le cadre du Festival des Familles, au Cinérex de Pontivy. La discussion, animée une nouvelle fois par Delphine Gicquel, s’est appuyée sur la présence de deux autres intervenantes, permettant de croiser les regards autour des thématiques abordées. Sandrine Henry, psychologue clinicienne ayant travaillé dans un Centre d’Accueil à la Parentalité, lieu de prévention pendant de nombreuses années et actuellement dans le champ de la protection de l’enfance (Beauvallon, Saint-Brieuc) et Fabienne Gomez, éducatrice spécialisée au PAEJ de Saint-Brieuc (Beauvallon) ont contribué à enrichir les échanges avec la salle, en apportant leurs perspectives issues de contextes professionnels différents.
Ce film raconte la temporalité du phénomène de harcèlement, de sa provenance à sa destination, de ses enjeux et de ses effets. Il cherche à saisir l’implication de chaque protagoniste, tout en frayant un chemin aux amitiés, aux histoires d’amour et aux relations familiales.
T’inquiète ! Cette interjection utilisée par Emma témoigne de ce qui ne peut se dire et ferme tout accès à la discussion. Cette formule dévoile un point d’impasse pour Emma. D’abord dans sa relation à Lou, une de ses amies, qui lui reproche de ne pas lui avoir dit qu’elle avait quitté son petit ami. Doit-on tout dire à ses ami(e)s ? Une succession d’événements va alors précipiter Emma vers le passage à l’acte.
Alors que les parents d’Emma perçoivent que leur fille ne se sent pas très bien, sa souffrance leur échappe. N’est-ce pas d’ailleurs la particularité de l’adolescence comme période qui échappe aux parents ? Car qu’est ce qui fait que des parents présents n’ont pas accès à la douleur qui ravage leur fille ? Les parents d’Emma cherchent à ajuster leur distance, chacun différemment avec leur fille. Ils se sentent dans l’impuissance alors qu’ils ne peuvent pas en faire plus. L’adolescent ne peut pas tout dire et les parents ne peuvent pas tout entendre. Comment alors faire la part des choses entre ce qui relève de l’adolescence ordinaire, qui peut être tumultueuse, et un adolescent en grande souffrance ?
Le film s’attache à distinguer comment chaque personnage est impliqué. Ainsi, Manon, sa meilleure amie, prend la mesure de ce qui est arrivé assumant une part de responsabilité : elle se sent coupable, embarrassée, coincée entre le groupe et soutenir son amie. Du côté de Lou pas de remise en question : elle se présente comme détachée, égocentrée, retournant toujours la situation contre l’autre. Sa position vient dire combien certains jeunes ne prennent pas la mesure et banalise ce qui se passe. Or, les histoires, les disputes, les bagarres… sont à prendre au sérieux ! La dimension pulsionnelle propre à l’adolescence avec la question de l’intime et du sexuel mène forcément à des embrouilles dans le lien à l’autre. Cela prend de la place dans leur vie. L’ouverture à un tiers, à un lieu d’écoute peut s’avérer pertinente, pas tant pour régler le conflit, que pour repérer la position que le jeune prend dans la relation à l’autre.
La discussion a aussi laissé place à un débat autour de l’usage du téléphone : il ne s’agit pas tant d’être nostalgique d’un temps d’avant, mais plutôt de s’interroger sur comment comment faire avec l’hyperconnexion, avec ces messages qui continuent après l’école ? La place de l’école, qui n’est pas abordée dans le film a longuement été dépliée avec les ressources que chaque élève peut y trouver (dispositif Phare, élèves ambassadeur, « helper », adulte de référence…).
Loin de chercher des réponses qui valent pour tous, les parents, grands-parents, adolescents, professionnels, ont témoigné de leurs propres inventions au quotidien pour se débrouiller avec les incontournables labyrinthes des relations qui trament cette « délicate transition ».
- Lacadée P., L’éveil et l’exil, enseignements psychanalytiques de la plus délicate des transitions, l’adolescence, Ed. nouvelles Cécile Dufaut, 2007.